Développement professionnel et remédiation
Apprenez-en plus sur le développement professionnel continu des médecins.
Pédagogue dans l’âme, la Dre Marie-France Pelland croit fermement en l’efficacité de la formation continue afin de rehausser la qualité des soins offerts au public. Récemment nommée à la tête de la Direction du développement professionnel et de la remédiation du Collège des médecins du Québec (CMQ), elle nous fait découvrir ce domaine qui la passionne!
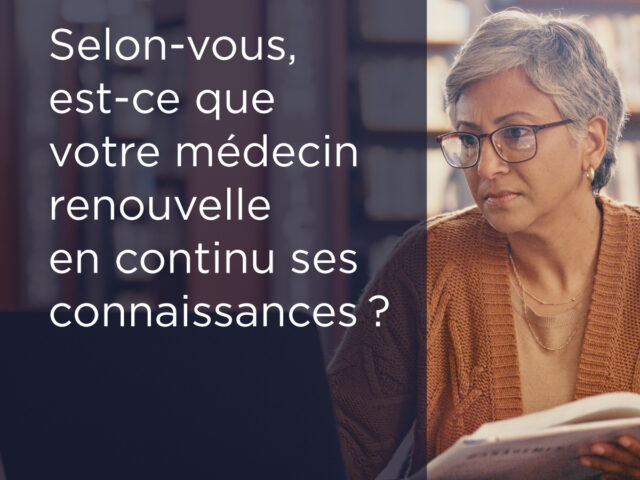
Sondage
Nous vous avons demandé si, à votre avis, votre médecin renouvelait en continu ses connaissances cliniques. Voici ce que les 337 personnes ayant répondu à notre sondage nous ont confié :
- OUI, selon 95 % d'entre elles
- NON, selon 5 % d'entre elles
La Direction du développement professionnel et de la remédiation (DDPR) est peu connue du grand public, puisque ses services sont offerts aux médecins. Essentiellement, elle s’occupe de tout ce qui concerne le développement professionnel continu (DPC) des médecins, un mandat qui se décline en différents volets.
Au total, une vingtaine de personnes œuvrent à la DDPR, dont cinq médecins, deux analystes, une cheffe de l’administration, une coordonnatrice et plusieurs agentes affectées à ses divers secteurs d’activités. « J’aime que nous réfléchissions ensemble sur les façons d’offrir le meilleur service possible aux médecins qui ont besoin de notre expertise », affirme la Dre Pelland, qui tient les rênes de la DDPR depuis l’automne 2023.
In this page
De la formation continue pour tous les médecins actifs
Afin d’assurer des soins de qualité à la population, la DDPR veille à l’application du Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins, en vigueur depuis 2019. Ce Règlement exige que les médecins actifs cumulent au moins 250 heures de formation continue par période de 5 ans, dont au minimum 125 heures d’activités de DPC reconnues et 10 heures d’activités d’évaluation de l’exercice professionnel reconnues.
Ce cadre réglementaire vise d’abord la protection du public : « La formation continue permet de s’assurer que les médecins demeurent compétents et suivent les nouvelles recommandations de prévention et de traitement, par exemple. Cela fait partie de la mission du Collège », explique la Dre Pelland.
Ce type de règlement n’est d’ailleurs pas l’apanage du CMQ. Les 46 ordres professionnels du Québec ont la responsabilité de favoriser le développement de leur profession respective et peuvent en faire l’objet d’un règlement1.
« Les médecins comprennent l’importance de se former et d’être à jour », soutient la Dre Pelland, qui estime que cette culture de l’amélioration continue est bien implantée au sein de la profession. D’ailleurs, le Code de déontologie des médecins, qui constituait la référence en matière d’obligation de DPC avant l’adoption du Règlement, stipule clairement que le médecin doit « développer, parfaire et tenir à jour ses connaissances et habiletés ».
Ouvrir ses horizons
En plus de se tenir à jour, la formation continue permet d’ouvrir ses horizons. La Dre Pelland en sait quelque chose : « Lorsque je pratiquais comme médecin de famille, j’avais tendance à privilégier les congrès en périnatalité, car c’est ce qui m’intéressait d’emblée et ce dans quoi j’étais à l’aise. »
Un jour, un collègue lui propose d’opter pour un congrès en ORL-ophtalmologie. La suggestion ne l’emballe pas d’entrée de jeu, mais elle se laisse convaincre. « Ce fut l’un des congrès les plus formateurs auxquels j’ai assisté. Sortir de sa zone de confort nous fait évoluer comme cliniciens. »
Le pouvoir de l’autocritique
Le Règlement prévoit certaines heures consacrées à l’évaluation de l’exercice professionnel, une démarche qui amène les médecins à poser un regard critique sur leur pratique. Aux yeux de la Dre Pelland, cette introspection est l’un des outils les plus puissants en formation continue : « En tant que professionnels, se remettre en question est essentiel. En réfléchissant sur nos incertitudes, en lien avec notre pratique, nous pouvons tirer des apprentissages qui seront bénéfiques, tant pour nous que pour nos collègues ou nos patients. »
Sur le plan personnel, l’autoévaluation aide à cerner ses forces et ses faiblesses : « Par exemple, si je réalise que la gestion de conflits est difficile pour moi en tant que médecin gestionnaire, je peux cibler des formations qui vont m’aider à développer des compétences à ce niveau », illustre-t-elle. Sur le plan clinique, il est d’autant plus important de reconnaître ses limites et d’aller chercher l’expertise nécessaire.
Un bilan après cinq ans
La fin de l’année 2023 a marqué l’aboutissement du premier cycle de cinq ans depuis l’entrée en vigueur du Règlement. Pourrait-on faire mieux en ce qui concerne son suivi et son application? « Certainement! », affirme la Dre Pelland. À la demande du Conseil d’administration (CA) du CMQ, un groupe de travail a d’ailleurs formulé des recommandations de changements à apporter dans la prochaine version du Règlement.
In this page
Des activités de perfectionnement conçues pour les médecins
Un autre volet central des activités de la DDPR consiste en l’organisation d’activités de développement professionnel, de perfectionnement et de remédiation pour certains médecins.
Dispositif pédagogique mis en place après évaluation […] pour combler des lacunes, corriger des apprentissages erronés. (Le Robert)
Ces activités répondent à une variété de besoins :
- mise à jour des connaissances dans des domaines particuliers;
- acquisition d’une compétence nouvelle afin de réorienter ou de bonifier sa pratique (par exemple, un médecin d’urgence qui souhaite amorcer une pratique en cabinet);
- mise à niveau ou correction de lacunes dans la compétence d’une ou d’un médecin en exercice;
- mise à jour de la compétence lors d’un retour à la pratique après une absence prolongée.
Portant sur diverses thématiques et d’une durée variable, les activités de perfectionnement et de remédiation prennent diverses formes : ateliers, tutorats ou stages chapeautés par des pairs. Chaque année, la DDPR organise quelque 300 activités de perfectionnement, ce qui tient l’équipe fort occupée.
Saviez-vous que le CMQ dispense près de 70 séances d’ateliers annuellement? Couvrant une douzaine de thèmes, ces activités de formation touchent principalement aux volets déontologiques et éthiques de la pratique médicale.
Une nouveauté à surveiller en 2024 : la formation de base en sécurisation culturelle des soins de santé. Cet atelier abordera les principes d’équité, de diversité et d’inclusion sous l’angle de la pratique médicale. On y réfléchira sur le racisme, le colonialisme et les formes d’oppression subies par différentes communautés.
Pour un aperçu des différents ateliers offerts par le CMQ, visitez la page Ateliers et webinaires de son site Web.
Pas toujours un choix…
Certains médecins s’inscrivent volontairement à une activité de perfectionnement, notamment dans le but d’élargir ou de changer leur domaine d’exercice. Pour d’autres médecins, la participation à une activité de perfectionnement leur est suggérée ou imposée, sur la base de lacunes observées dans leur pratique lors d’une inspection professionnelle ou d’une enquête menée par le CMQ.
Lorsqu’une lacune est constatée, la DDPR collabore de près avec la Direction de l’inspection professionnelle (DIP) afin de déterminer la meilleure méthode pédagogique à employer, selon la situation. C’est ensuite au responsable de l’inspection professionnelle d’approuver le choix d’activité et d’en aviser le médecin.
La plupart du temps, les médecins acceptent d’emblée la proposition de suivre un atelier, un stage ou un tutorat. En cas de refus, il revient au comité d’inspection professionnel (CIP) de trancher et, si nécessaire, d’imposer l’activité de perfectionnement, avec ou sans limitation de l’exercice professionnel.
Des stages et tutorats « sur mesure »
Le CMQ mise de plus en plus sur l’approche pédagogique auprès des membres : « Une activité de perfectionnement permet de bien accompagner les médecins afin qu’ils aient une pratique contemporaine et sécuritaire », précise la Dre Pelland.
Lors d’un stage, le médecin adopte une posture semblable à celle d’un résident en médecine, se rapportant à un superviseur. Quant au tutorat, il consiste plutôt en un accompagnement individuel. Les périodes de tutorat sont l’occasion de revoir avec le médecin ses notes de dossiers, de discuter de certains cas ou encore d’effectuer des simulations. Dans certains cas, il y aura une observation directe, sur le lieu de travail du médecin. « Chaque activité est personnalisée et adaptée aux besoins du médecin, il n’y a pas de format unique », explique la Dre Pelland.
L’approche semble profitable , puisque la majorité des participants se disent satisfaits au terme de l’expérience. Dans la plupart des cas, lorsque les activités découlent d’un processus d’inspection professionnelle, on observe d’ailleurs une amélioration de la pratique lors des visites de contrôle.
le CMQ est toujours à la recherche de nouveaux maîtres de stage et tuteurs dans une variété de spécialités. Voilà une belle occasion de soutenir une ou un collègue en partageant vos connaissances! Ce rôle vous intéresse? Pour en savoir davantage, écrivez à activite-perfectionnement@cmq.org.
Les entrevues orales structurées
Chaque année, la DDPR organise par ailleurs une trentaine d’entrevues orales structurées (EOS), une méthode d’inspection professionnelle qui fait appel à différents scénarios et contextes simulés. Utilisées depuis 1990 en médecine de famille, les EOS se sont graduellement développées dans d’autres spécialités : radiologie, psychiatrie, pathologie, dermatologie, anesthésiologie et médecine d’urgence. Pour chacune des EOS, le CMQ fait appel à deux médecins experts, issus de la spécialité concernée.
Lors des EOS, on utilise des vignettes cliniques (cas) pour évaluer certains aspects de la pratique du médecin. Par exemple, en radiologie ou en dermatologie, il peut s’agir de présenter des images au médecin afin de s’assurer qu’il pose le bon diagnostic. En médecine de famille, la vignette peut prendre la forme d’une mise en situation, dans laquelle une comédienne ou un comédien jouera le rôle du patient. À partir d’un scénario bien défini, le « patient simulé » interagira avec le médecin en lien avec différents problèmes de santé (état dépressif, douleur au genou, maux de tête, etc.).
Plusieurs de ces EOS sont réalisées dans les bureaux du CMQ. Pour l’anesthésiologie et la médecine d’urgence, les EOS se dérouleront dans un centre de simulation, en ayant recours à des mannequins. C’est ainsi qu’on évaluera la capacité du médecin à reconnaître et à prendre en charge certaines urgences médicales. Enfin, en pathologie, certaines portions de l’EOS sont réalisées sur le lieu de travail même du médecin.
« Nous sommes en voie de réaliser notre 500e EOS cette année ! », lance avec fierté la Dre Pelland, qui a contribué au développement de ces outils d’évaluation. Son équipe organise les EOS, qui relèvent cependant du directeur de l’inspection professionnelle, le Dr Anas Nseir.
In this page
Un suivi administratif en cas de problèmes de santé
La DDPR gère également le Programme de suivi administratif des médecins ayant des problèmes de santé physique ou mentale susceptibles de compromettre l’exercice professionnel de la médecine. De diverses natures, ces problèmes de santé physique ou mentale ont en commun leur impact potentiel sur la protection du public. Sur une base volontaire, le médecin qui adhère à ce programme confidentiel autorise le CMQ à communiquer régulièrement avec son médecin traitant, afin de confirmer qu’il est toujours apte à exercer la médecine. En place depuis 25 ans, le programme fait l’objet d’une réévaluation, pour bien répondre aux besoins du terrain.
In this page
Se former pour être en phase avec la société
Chose certaine, tant que la médecine et la société évolueront, les besoins de perfectionnement et de formation demeureront présents. « Au cours des prochaines années, les médecins devront être sensibilisés à des principes émergents dans la société, tels que la responsabilité sociale, l’équité, la diversité et l’inclusion et la sécurisation culturelle », mentionne la Dre Pelland.
C’est sans compter les défis qui attendent les médecins sur le plan de l’évolution technologique, avec les nouvelles responsabilités qui découleront de l’usage de l’intelligence artificielle, par exemple. Bref, on ne finit jamais d’apprendre… et c’est tant mieux!
In this page
Pour mieux connaître… la Dre Marie-France Pelland

Dre Marie-France Pelland
- Elle a exercé la médecine de famille pendant près de 20 ans au GMF-U Bordeaux-Cartierville et pratiqué en obstétrique à l’Hôpital du Sacré-Cœur.
- Elle a évolué dans le milieu universitaire en tant que professeure adjointe de clinique et leader pédagogique au Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé de l’Université de Montréal.
- Arrivée au CMQ à titre d’inspectrice en 2016, elle se joint à l’équipe de la remédiation et des EOS en 2018, puis devient directrice du développement professionnel et de la remédiation en 2023.
En quoi le fait d’avoir pratiqué la médecine de famille durant une vingtaine d’années teinte-t-il votre approche en tant que directrice?
J’étais passionnée par mon travail de médecin de famille et d’enseignante, tout comme je le suis par mon rôle de gestionnaire. Je crois que l’expérience clinique est très importante pour comprendre les défis vécus par les médecins sur le terrain.
Quelle activité de formation continue vous a été la plus utile?
J’ai suivi la formation ICLEM (Institut canadien de leadership en éducation médicale) qui a été déterminante dans mon parcours. Je cumulais une dizaine d’années de pratique à l’époque. Cette formation m’a aidée à me projeter dans l’avenir et à établir un plan de carrière. J’y ai beaucoup appris sur l’efficacité, la communication, la résolution de conflits et l’implantation de changements, entre autres.
De quel accomplissement êtes-vous la plus fière?
Avec des collègues de l’Université de Montréal, j’ai contribué à la création du programme de formation Relève Leadership, destiné aux médecins pressentis pour occuper des postes de gestion. Ayant coanimé certaines activités de ce programme pendant près de 10 ans, j’y ai rencontré des gens passionnés qui m’ont exprimé à quel point la formation leur avait été bénéfique, en plus de recevoir une rétroaction très positive de certains directeurs de département.
1 Pour en savoir davantage, consultez la page « Ordres professionnels » du site de l’Office des professions du Québec.